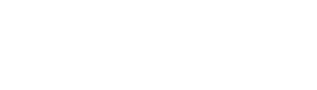Profession notaire
Les notaires assument leur mission de service public sur l’ensemble du territoire. Ils contribuent à la vie économique du pays, ainsi qu’en témoignent ces données statistiques :
8494 notaires dont 6268 notaires exercent sous la forme associée au sein de 2660 sociétés.
4513 offices auquel il faut ajouter 1302 bureaux annexes ce qui porte à 5815 le nombre de point de réception de la clientèle sur tout le territoire.
Plus de 48000 salariés dont 82% de femmes et 18% d’hommes. En ajoutant les notaires on compte un peu plus de 56000 personnes travaillant dans les offices.
1929 notaires sont des femmes.
L’âge moyen est de 49 ans.
Chaque année, les notaires :
- reçoivent 20 millions de personnes,
- traitent des capitaux d’un montant de 600 milliards d’euros,
- établissent 4,3 millions d’actes authentiques,
- réalisent un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros
- Immobilier, ventes construction, baux : 49 %
- Actes liés au crédit : 14 %
- Actes de famille, succession : 26 %
- Négociation immobilière : 4 %
- Droit de l’entreprise, conseil, expertise, conseil patrimonial : 7 %
Histoire de la profession
Au troisième siècle de notre ère, durant le Bas Empire romain, des fonctionnaires dont le rôle s’apparentait à celui des notaires, authentifiaient déjà des contrats au nom de l’État. La colonisation introduisit l’institution en Gaule, et les « notaires gaulois » rédigeaient des actes, notamment en vue de recenser les terres pour déterminer l’assiette de l’impôt foncier.
L’institution disparaîtra avec les invasions barbares et fera sa réapparition au IXème siècle en vertu d’un capitulaire de Charlemagne.
Saint-Louis, peu avant sa dernière croisade, en 1270, et Philippe le Bel, en 1302, contribuèrent à développer le rôle du notaire. On doit au premier la nomination, au Châtelet, de 60 notaires qui instrumentent au nom du prévôt. On doit au second l’extension de la fonction notariale à l’ensemble des domaines placés sous l’autorité du souverain.
Au XVIème siècle, la France est devenue une nation. En 1539, par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, François Ier préfigure ce que sera l’organisation de la profession de notaire: les actes devront être rédigés en français, la conservation devra en être assurée et leur existence devra être consignée dans un répertoire. En 1597, Henri IV fait du notaire le détenteur du sceau de l’Etat.
A l’issue du plus grand conflit de tous les temps, l’ordonnance du 2 novembre 1945 dote le notariat de structures institutionnelles et crée le Conseil supérieur du notariat. A partir de cette époque, la profession connaît un développement considérable, rendu, en particulier, nécessaire par la reconstruction de la France à laquelle le notariat apporte une contribution essentielle, dans les domaines juridiques et fiscaux. Le droit connaît alors une évolution fulgurante. Le pouvoir politique réforme la plupart des institutions ou en crée de nouvelles, dans de très nombreux domaines. Dans le même temps, la réglementation de l’urbanisme connaissait des dizaines de modifications ponctuelles, tandis que deux droits nouveaux faisaient leur apparition : celui relatif à la défense des consommateurs et celui relatif à la défense de l’environnement. Bref, en moins d’un demi-siècle, le droit devait subir plus de modifications qu’il n’en avait connues depuis cent cinquante ans. Le notariat, au prix d’efforts considérables, techniques et financiers sut faire face et s’adapter à tous ces bouleversements.
Formation
Le maître en Droit désirant accéder aux fonctions de notaire a le choix entre deux formations coordonnées par le Centre National de l’enseignement Professionnel Notarial (CNEPN) : la voie professionnelle et la voie universitaire.
Ce régime dont les modalités ont été instaurées par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié a une durée de trois ans.
1ère année :
1) Examen d’admission : 1 session par an – 3 présentations maximum. Les maîtres en droit titulaires du diplôme de 1er clerc en sont exemptés.
2) Enseignement à temps plein par un Centre de formation professionnelle notariale.
3) Participation active à un enseignement théorique et pratique par méthode des cas, et accomplissement de deux mois de pré-stage.
4) Examen de sortie (écrit et oral), un seul redoublement possible, sauf décision spéciale du Conseil d’Administration de CFPN.
5) Délivrance par le CNEPN du « diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire ».
2 ans de stage :
1) Inscription sur le registre de stage du Centre de Formation Professionnelle Notariale dont dépend l’office dans lequel le candidat a été embauché en qualité de « notaire-stagiaire ».
2) Statut de salarié, employé et rémunéré à temps plein, avec affiliation à la Caisse de Retraite des Clercs (CRPCEN).
3) Participation effective et assidue » aux six séminaires du Centre de formation professionnelle notariale : contrôle continu des connaissances et rédaction, infine, d’un rapport de stage. Possibilité, à titre de sanction, d’une ou deux années de stage supplémentaires.
4) Délivrance par le Centre de formation d’un certificat de fin de stage permettant avec le « diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire », de présenter requête à la Chancellerie pour nomination.
La voie universitaire
Instaurée par le décret du 5 juillet 1973 modifié et dont les modalités sont fixées par arrêté du 5 juillet 1973 modifié, elle a une durée de 3 ans au moins, compte-tenu du délai de rédaction du « mémoire ».
1ère année :
Le maître en droit, demeurant étudiant ou étant déjà salarié, notamment chez un notaire, poursuit ses études en faculté de Droit pour obtenir le Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) de Droit notarial.
2 ans de stage :
1) Double inscription : à l’une des Universités habilitées par le Ministre de l’Enseignement supérieur et ayant passé convention avec le CNEPN, et sur le registre de stage du Centre de formation professionnelle dont dépend l’office dans lequel le candidat a été embauché en qualité de stagiaire. Universités habilitées : Aix – Marseille III, Bordeaux I, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon III, Montpellier I, Nancy, Nantes, Paris I, Paris II, Paris V, Paris X-Nanterre, Paris XII, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.
2) Statut de salarié, employé et rémunéré à temps plein, avec affiliation à la Caisse de Retraite des Clercs (CRPCEN).
3) Participation active à l’enseignement dispensé conjointement par l’Université et le Centre, sous forme de travaux dirigés et séminaires, divisé en 4 semestrialités sanctionnées chacune.
4) Soutenance d’un mémoire devant un jury spécial, et délivrance par l’Université du « Diplôme Supérieur de Notariat » (DSN), diplôme mixte, universitaire et professionnel, qui permet de présenter requête à la Chancellerie pour nomination.
Pour tous renseignements, contactez le CNEPN : cnepn@notaires.fr